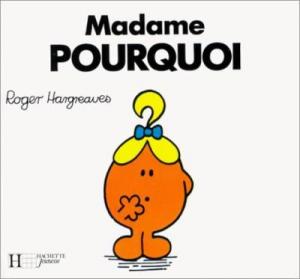Crois tu, crois tu vraiment que nous sommes forts ?
Au milieu des dunes décharnées, le sera-t-on assez pour nous faire un abri de la chaleur de nos deux corps ? Mon amoir, Ne crains tu pas que les collines coléreuses ne nous avalent ? Les collines s’effritent sous le temps, les collines ont vécu bien trop longtemps, les collines agonisent, languissantes et toujours à la merci des minutes qui, s’ensommeillant, les oublient, les soumettent comme des fétu des pailles. Elles se meurent et elles en crèvent, ces dunes-immensité sur lesquelles, outrageusement, on s’allongue, on s’embrasse, on s’enlace et, sans lasse, on s’y fond l’un en l’autre.
Mon aimé, ces avides prêtresses, les collines au sable anémié, les as tu seulement remarquées ? Elles épousent nos formes étendues, s’assouplissent et se creusent, enveloppent nos membres. Mourantes qu’elles sont, foulées depuis des siècles, obligées de subir les assauts de nos corps mouvants, furieusement elles nous assaillent.
Sur elles, nous nous abandonnons, nos pâles mèches des cheveux ne s’y distinguent plus tandis qu’on s’y roule. Et alors, pendant que nous reprenons lentement nos souffles, ces assoiffées harassées tentent d’aspirer nos vies, l’étincelle essentiel nous animant ; collées à nos nudités, on peut les sentir, s’agrippant telles des sangsues.
Elles, elles qui jamais n’ont pu prendre formes, prendre corps, s’arracher à la terre et s’épanouir. Elles, soumises à l’ordre des choses, soumises à l’ordre de rester des masses étendues, compagnes immortelles de la mer. Elles se rebellent, ne les sens tu pas ? Elles se révoltent car elles expirent, car elles ont compris qu’elles sont aussi mortelles que nous deux (oui mon amour, nous allons mourir, nous aussi).
Alors, vengeresses éperdues, elles s’acharnent contre nous, charnels, elles cherchent. Quel combat pour nous arracher ce qui nous brûle debout ? Quel assaut pour nous réduire, comme elles, à une masse compacte de matière froide, reposé ?
Et nous sommes tout petits contre elles, face à la mer, la mère, la source insufflant le sel sur nos bouches pour les attirer l’une sur l’autre. Nous brûlons debout, oui, mais la brûlure devient fièvre dévorante sous le soleil, et nos jambes déjà flageolent, se brisent. Alors, contre ces dunes qui se meurent, et veulent kidnapper le feu de nos ventres, crois tu, ô mon aimé, crois tu vraiment que, serrés l’un contre l’autre, nous serons assez forts pour leur donner tort ? Les repousser, entremêler nos jambes pour que jamais nous ne soyons mis à terre ?
Pense tu, d’une pensée claire, sans l’influence des fards rougeoyants, rayonnants du sentiment, pense tu que nous pourrons être de tels forts, des forteresses à la fermeté inattaquable, mon ventre sur ton ventre, tes jambes entre mes jambes ? Si tous les éléments s’éprennent d’une folie meurtrière, si tout s’efface, si tout se détachent, nous, que serons nous ?
Saurons nous exister toujours ? Fiers, redressés, sans la moindre écorchure. A serrer si forts nos chairs les unes contre les autres qu’elles se seraient fondues en un seul amas de nerfs, de sang, de peau. Corps muté devenu un, entier, et doté d’un seul esprit qui ne saurait plus qu’au commencement, il était deux, deux épris, si forts qu’ils ont transformés toutes les lois de la nature. Fondus, brûlants toujours, débarrassés de tout les superflus de l’âme et du corps. Les petits utilitaires du corps pour se défendre, disparus, car contre quoi se défendre, Mon Tendre, si nous sommes un, enfin ?
Nos dents ou nos ongles, ainsi, qui se sont si souvent heurtés ou croqués par le passé, se seront réduits en une poudre plus fine et plus blanche que le traître sable. Nos dents ou nos ongles, en une infinité de miettes superflues, giseront au milieu du vent, se perdront dans les bourrasques, se répandront dans le monde entier, et termineront paisiblement leur course, grains par grains. L’un, le premier fragment broyé, finira sur les draps immaculés de deux amants au premier soir, visages rougissants et bras pudiques. Un autre, la dernière parcelle de notre dureté ancienne et consumée, l’infinie dernière, ira se déposer sur le corps livide d’un homme s’étant calciné l’esprit, à la peau maintenue chaude et humide par des larmes, celles versés infiniment par l’aimante toujours vivante, et désormais séparée, de cet âme là, envolée.
J'a plus trop a dire ici sans doute. Peut etre que je devrais créer une autre page. Peut etre qu'ici ça commence a se gangréner. J'sais pas.