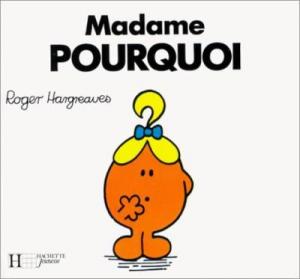Ce jour là, cette place là, cet après midi là.
Dans la vi(ll)e, j'étais un corps étranger.
Cette ville a un je ne sais quoi d'espoir inaccessible, beau et déçu, de vie qui glisse sur la peau sans la franchir.
Allongué sur le trottoir, j'entend les sons. J'entend les voix, leurs enthousiasme, leur bonheur. Pouvoir communiquer, savoir communiquer, avoir quelque chose à dire, avoir quelqu'un a qui le dire. C'est déjà ça un peu, leurs bonheurs de l'instant : avoir la sensation d'appartenir au monde.
Tout glisse, et rien ne pénètre. Dans la foule si frêle, les regards m'effleurent machinalement, comme un mur blanc.
Le silence.
La batterie me colle aux tempes, la basse s'est insinué dans ma poitrine jusqu'a guider le rythme de mon sang.
Pourtant, la vide du silence, il est assourdissant.
...Monsieur_Cana_after_Edvard_Munch_Qalandia_check_point_in_Palestine.jpeg/398px-Le_Cri.The_Scream_(Skrik,_1893)...Monsieur_Cana_after_Edvard_Munch_Qalandia_check_point_in_Palestine.jpeg)
La joue sur le bitume, je regarde le corps des passants.
C'est drôle. On croirait qu'ils existent.
Le soleil me brule la cervelle. Pas que le soleil.
J'examine.
je pourrait m'ouvrir le corps, écarter ma chemise artificiellement colorée et rompre du tranchant d'un scalpel la peau hideuse de mon ventre : je pourrais examiner la chair suintante, les tendons blancs lavés du sang, les poumons comme une foret de cauchemar. Je pourrais, sans plus rien ressentir
Tout cela, c'est extérieur. Entre lui et moi, une ouate épaisse et dégueulasse s'est installé. Entre la réalité et les pulsations de mes veines.
De l'espoir nébuleux en guise de morphine. Que chacun choisisse sa drogue, elles ont un terrible même point commun : la violence de la descente, patchwork de souffrances différentes et vivaces, evanescentes par éclair.